
Près de deux foyers français sur trois possèdent un animal de compagnie, représentant environ 62 millions d'animaux en France. Le bien-être animal, défini comme "l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que ses attentes", est devenu une préoccupation majeure pour les propriétaires d'animaux et la société en général.
Selon l'Organisation mondiale de la santé animale, le bien-être animal désigne "l'état physique et mental d'un animal en relation avec les conditions dans lesquelles il vit et meurt". Ce concept s'articule autour des 5 principes du bien-être animal, également connus sous le nom des cinq libertés fondamentales, énoncées en 1965 et universellement reconnues. Ces libertés comprennent l'absence de faim, de soif et de malnutrition ; l'absence de peur et de détresse ; l'absence de stress physique ou thermique ; l'absence de douleur, de lésions et de maladie ; ainsi que la liberté d'exprimer un comportement normal de son espèce. Ces principes essentiels forment la base de notre compréhension actuelle du bien-être animal et guident les pratiques dans ce domaine.
Comprendre le bien-être animal en 2025
En 2025, la façon dont nous comprenons et traitons le bien-être animal a considérablement évolué. Cette notion, autrefois marginale, s'est progressivement imposée comme un élément fondamental dans notre relation avec les animaux, qu'ils soient d'élevage, de compagnie, utilisés à des fins scientifiques ou même dans les zoos.
Définition selon l'ANSES et l'OMSA
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (ANSES) définit le bien-être animal comme "l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes" [1]. Cette définition souligne particulièrement que cet état varie selon la perception que l'animal a de sa situation. Au-delà d'une simple absence de souffrance, elle reconnaît explicitement la dimension mentale et subjective du bien-être.
De manière complémentaire, l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) précise que le bien-être animal désigne "l'état physique et mental d'un animal en relation avec les conditions dans lesquelles il vit et meurt" [2]. Ces deux définitions convergent vers une compréhension holistique qui intègre :
-
La santé physique
-
L'état mental et émotionnel
-
La satisfaction des besoins propres à l'espèce
-
La perception subjective de l'animal lui-même
Il est important de noter que l'ANSES a porté une attention particulière aux bases scientifiques de cette notion, qui repose sur les caractéristiques psychiques des animaux, considérés comme des êtres sensibles et doués de différents niveaux de conscience [1]. Cette approche multidisciplinaire tient compte des avancées récentes en éthologie, science qui étudie objectivement les comportements des animaux dans leur environnement naturel [1].
Différence entre bien-être et bientraitance
Une distinction fondamentale existe entre les concepts de "bien-être" et de "bientraitance", souvent confondus dans le langage courant. Cette différence est pourtant essentielle pour comprendre les enjeux actuels de la protection animale.
La bientraitance correspond à l'ensemble des actions mises en œuvre par l'homme pour essayer d'atteindre pour l'animal un état de bien-être [3]. Elle se concentre sur les moyens fournis par l'humain et non sur le résultat ressenti par l'animal. Comme le souligne Luc Mounier, responsable de la Chaire bien-être animal : "Avec la bientraitance, on est dans une obligation de moyens, tandis qu'avec le bien-être on est dans une obligation de résultats" [3].
Concrètement, on peut "bien traiter" un animal sans que ce dernier soit effectivement en état de bien-être [3]. Le concept de bientraitance met l'accent sur la qualité des conditions que l'homme accorde à l'animal placé sous sa dépendance, mais sans nécessairement prendre en compte sa sensibilité propre [3]. Elle néglige parfois le besoin fondamental de l'animal d'exprimer le comportement propre à son espèce.
En revanche, le bien-être est un objectif de résultats beaucoup plus exigeant [3]. Il nécessite d'évaluer non pas ce que fait l'humain pour l'animal, mais la façon dont l'animal ressent son environnement et les soins qui lui sont prodigués [3]. Pour simplifier, "bien traiter" un animal, c'est ne pas le maltraiter et lui assurer de quoi vivre. Mais ce n'est pas nécessairement lui procurer le sentiment d'un agrément de vivre, un véritable bien-être [3].
Les quatre premières libertés fondamentales (absence de faim/soif, de peur/détresse, de stress physique/thermique, et de douleur/lésions/maladies) constituent la bientraitance. Cependant, c'est la cinquième liberté - permettre à l'animal d'exprimer les comportements génétiquement propres à son espèce - qui marque véritablement le passage de la simple bientraitance au bien-être [3].
Pourquoi cette notion est-elle devenue centrale ?
Plusieurs facteurs expliquent pourquoi le bien-être animal occupe désormais une place prépondérante dans notre société :
-
Évolution des connaissances scientifiques : les avancées en éthologie et en sciences cognitives ont considérablement enrichi notre compréhension de la sensibilité et de la conscience animales. La recherche scientifique a contribué à faire reconnaître la sensibilité des animaux comme un fait établi [4].
-
Reconnaissance juridique : la loi du 16 février 2015 a introduit dans le Code civil français le concept selon lequel les animaux sont des êtres vivants "doués de sensibilité" [4]. Cette évolution juridique reflète un changement profond dans notre perception des animaux.
-
Préoccupation sociétale croissante : le bien-être des animaux qui vivent sous la dépendance des humains prend une place de plus en plus importante dans notre société [1]. Cette notion est désormais omniprésente dans les attentes des consommateurs et des citoyens, les cahiers des charges, la réglementation et les initiatives marketing [4].
-
Question de politique publique : le bien-être animal est devenu une question de politique publique de plus en plus cruciale, tant au niveau national qu'international [2]. Des mesures concrètes ont été mises en place, comme l'obligation depuis 2022 pour tous les élevages d'animaux domestiques et d'animaux sauvages en captivité de désigner un référent en charge du bien-être animal [4].
-
Lien avec la durabilité : l'amélioration du bien-être animal dans l'élevage fait désormais partie intégrante de l'acceptabilité sociale de l'utilisation des animaux et, par conséquent, de la durabilité des chaînes d'approvisionnement alimentaire [2].
-
Avantages multiples : au-delà des questions éthiques, l'amélioration du bien-être animal présente de nombreux avantages, comme un élevage et une production plus durables, ainsi que des interactions humaines plus positives avec tous les animaux [2].
-
Évolution des comportements de consommation : dans de nombreux pays, les consommateurs achètent de plus en plus d'aliments produits localement pour des raisons environnementales et cherchent à éviter aux animaux vivants la douleur et le stress causés par le transport sur de longues distances [2].
Cette préoccupation n'est pas seulement théorique. Elle se traduit par des actions concrètes, comme la loi du 30 novembre 2021 contre la maltraitance animale qui renforce les sanctions pénales en cas d'abandon, rend obligatoire la signature d'un certificat d'engagement avant l'adoption d'un animal, et prévoit le retrait progressif des animaux sauvages dans les cirques itinérants [4].
La prise en compte du bien-être animal émerge systématiquement lorsque les humains interfèrent avec les animaux. Elle concerne non seulement l'élevage, mais également l'utilisation des animaux à des fins de recherche scientifique, d'enseignement, les activités de chasse, de pêche ou encore les activités sportives et culturelles comme les zoos [4].
Les 5 libertés fondamentales expliquées
Les 5 libertés fondamentales constituent le cadre de référence incontournable pour évaluer et promouvoir le bien-être animal. Énoncés pour la première fois en 1965 et universellement reconnues, ces principes directeurs orientent désormais l'ensemble des travaux de l'Organisation mondiale de la santé animale [5]. Initialement conçus pour les animaux d'élevage, ces principes transcendent aujourd'hui leur cadre d'origine pour s'appliquer à tous les animaux placés sous la responsabilité humaine [6]. Examinons en détail chacune de ces libertés fondamentales.
1. Absence de faim, de soif et de malnutrition
Cette première liberté concerne les besoins physiologiques les plus élémentaires de l'animal. Elle implique un accès permanent à de l'eau fraîche et à une alimentation adaptée, en qualité comme en quantité [1]. Concrètement, cela signifie :
-
Fournir une nourriture équilibrée correspondant au type, à l'âge et à l'activité de l'animal
-
Assurer un accès libre et constant à de l'eau propre
-
Adapter les rations alimentaires aux besoins spécifiques de chaque espèce
Pour les éleveurs, cette liberté représente un enjeu fondamental : des animaux bien nourris sont des animaux apaisés qui développent naturellement une meilleure résistance aux maladies [3]. Comme le témoigne un éleveur du Nord Togo pour Élevage sans frontières : "Des animaux qui mangent bien, ce sont des animaux en bonne santé, qui se sentent bien et qui produisent bien" [3].
Dans la nature, la malnutrition figure parmi les principales causes de mortalité animale, particulièrement chez les jeunes individus [7]. Ainsi, garantir cette première liberté n'est pas seulement une question d'éthique, mais aussi de survie et de développement optimal pour l'animal.
2. Absence de peur et de détresse
La dimension psychologique du bien-être animal est au cœur de cette deuxième liberté. Elle vise à prévenir toute souffrance mentale en adoptant des conditions et des pratiques qui ne génèrent ni peur ni détresse [8].
Pour assurer cette liberté, plusieurs approches sont recommandées :
-
Créer un environnement apaisant et sécurisé
-
Adopter des gestes doux et rassurants lors des manipulations
-
Séparer les animaux par âge ou par sexe lorsque cela est nécessaire
-
Éviter la présence d'éléments stressants (comme des prédateurs potentiels)
En pratique, cette liberté se traduit par des aménagements concrets comme l'installation de lieux sécurisés pour les jeunes animaux ou l'établissement d'un lieu fixe et calme pour la traite [3]. Parfois, cela implique même un investissement personnel significatif, comme de dormir avec son élevage [3].
3. Absence de stress physique ou thermique
Cette liberté concerne principalement le confort physique de l'animal et sa capacité à s'adapter aux variations de son environnement. Elle implique de fournir un abri adéquat et une aire de repos confortable [1], permettant aux animaux d'éviter les températures extrêmes et les intempéries.
Le stress thermique constitue une préoccupation majeure pour le bien-être animal. Qu'il s'agisse de fortes chaleurs ou de grands froids, les variations importantes de température peuvent avoir des conséquences graves sur la santé des animaux [9]. Pour les animaux d'élevage notamment, ces variations peuvent affecter :
-
La consommation alimentaire
-
La production (lait, œufs, etc.)
-
Le comportement général
-
La fertilité
-
La résistance aux maladies
Pour lutter contre le stress thermique, plusieurs solutions existent : construction de bâtiments adaptés, installation de zones d'ombrage, aménagement d'aires de circulation permettant aux animaux d'accéder à l'extérieur [3]. Ces dispositifs visent à offrir un espace de tranquillité sécurisé, garantissant ainsi le bien-être et, par extension, la productivité des élevages.
4. Absence de douleur, de lésions et de maladie
Cette quatrième liberté concerne la santé physique de l'animal et sa protection contre la souffrance. Elle repose sur trois piliers essentiels : la prévention, le diagnostic rapide et le traitement approprié [1].
Concrètement, cette liberté implique :
-
Le développement de pratiques préventives d'hygiène
-
L'entretien régulier des lieux de vie
-
La mise en place de services vétérinaires accessibles
-
Le déparasitage et la vaccination systématiques
-
La formation d'auxiliaires d'élevage
Une approche préventive passe par des gestes quotidiens simples mais essentiels : inspection des mangeoires et abreuvoirs, nettoyage régulier des installations, observation attentive des comportements inhabituels [3].
Par ailleurs, lorsqu'une maladie survient, la rapidité d'intervention est cruciale. L'accès aux soins vétérinaires représente donc un enjeu majeur, particulièrement dans les régions où les professionnels de santé animale sont peu nombreux [3].
5. Liberté d'exprimer un comportement naturel
Cette dernière liberté, souvent considérée comme celle qui distingue véritablement le bien-être de la simple bientraitance, concerne la possibilité pour l'animal d'exprimer les comportements normaux propres à son espèce [1]. Elle implique :
-
Un espace suffisant et adapté
-
Des installations appropriées
-
La possibilité d'interactions sociales avec des congénères
Cette liberté reconnaît que chaque espèce possède un répertoire comportemental spécifique qu'il est essentiel de respecter pour assurer son bien-être psychologique. Pour les animaux d'élevage, cela peut se traduire par l'accès à un espace extérieur permettant le jeu, la recherche d'alimentation ou les interactions sociales [3].
Comment évaluer le bien-être animal ?
L'évaluation du bien-être animal constitue un défi majeur pour les professionnels et les scientifiques. Pour déterminer si un animal bénéficie réellement d'un état de bien-être, il ne suffit pas de supposer que des conditions d'élevage adéquates garantissent automatiquement cet état. Une évaluation rigoureuse et objective s'impose, fondée sur l'observation des animaux eux-mêmes et non uniquement sur l'analyse de leur environnement.
Méthodes d'observation comportementale
L'observation du comportement des animaux représente l'élément fondamental de toute évaluation du bien-être. En effet, le comportement constitue généralement l'indicateur le plus sensible et précoce d'une dégradation du bien-être animal. Pour réaliser cette observation de manière efficace, plusieurs approches sont possibles :
L'observation directe permet d'évaluer le comportement des animaux dans leur environnement quotidien. Cette méthode nécessite une présence discrète de l'observateur pour ne pas influencer le comportement naturel des animaux. Les observations peuvent être notées sur des fiches ou enregistrées au moyen d'un dictaphone ou d'un caméscope, selon le type de comportement étudié et la précision recherchée.
Plusieurs méthodes d'échantillonnage comportemental existent pour répondre à différentes questions : fréquence d'apparition d'un comportement, temps consacré à certaines activités, ou encore enchaînement des comportements. Le choix d'une méthode adaptée à la question posée est primordial.
Des moyens indirects d'observation, comme les pièges photographiques, permettent également de suivre les animaux dans des conditions de visibilité réduite (milieux forestiers, nuit). La programmation de ces dispositifs est assimilable à une méthode d'échantillonnage comportementale.
Parmi les indicateurs comportementaux importants à observer, on note :
-
La modification de l'activité normale (changement de fréquence d'un comportement habituel)
-
L'apparition de comportements anormaux (stéréotypies par exemple)
-
Les réactions de stress (notamment physiologiques comme l'augmentation du cortisol)
-
Les performances productives (souvent diminuées face à une contrainte)
-
Les indicateurs sanitaires (qui sont toutefois moins sensibles et plus tardifs)
Il est essentiel de souligner que ces indicateurs comportementaux sont généralement les plus précoces à se manifester en cas de dégradation du bien-être, d'où l'importance cruciale de leur observation régulière.
Utilisation de l'éthologie
L'éthologie, science qui étudie objectivement les comportements des animaux, joue un rôle fondamental dans l'évaluation du bien-être animal. Cette discipline scientifique analyse, interprète et répertorie les comportements des animaux dans leur milieu naturel, puis permet une meilleure compréhension de ces mêmes comportements en milieu d'élevage.
Cette science s'avère particulièrement précieuse car elle permet d'identifier ce qui constitue un comportement normal ou anormal pour chaque espèce. Comme le souligne un document du Muséum national d'Histoire naturelle : "L'éthologie joue un rôle énorme dans de nombreux domaines ; elle est notamment cruciale pour le bien-être des animaux" [10].
Pour évaluer correctement le bien-être d'un animal, une connaissance approfondie des comportements propres à son espèce est indispensable. Seule cette expertise permet d'émettre un jugement véritablement objectif sur son état. Cette approche rejoint la définition même du bien-être animal donnée par l'ANSES, qui insiste sur "l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes" [11].
L'éthologie contribue également à rendre ces connaissances accessibles au grand public, ce qui conduit à un plus grand respect des animaux [12]. En comprenant mieux les comportements naturels de certaines espèces, on peut mieux appréhender leurs besoins réels et ainsi optimiser leur bien-être.
L'outil Welfare Quality
Face à la nécessité d'harmoniser les méthodes d'évaluation du bien-être animal, un outil de référence a été développé au niveau européen : le Welfare Quality®. Conçu dans le cadre de deux importants programmes européens successifs (2004-2009 puis 2011-2014), cet outil marque un tournant décisif en privilégiant une approche "animal-centrée" [13].
Le projet Welfare Quality® a regroupé 44 instituts de recherches et universités de 20 pays, principalement européens mais aussi d'Australie et d'Amérique latine [4]. Son objectif, comme le résume Harry Blokhuis, coordinateur du projet, était de "disposer d'une méthodologie permettant en quelques heures d'attribuer une note incontestable du bien-être animal, valable de la Grèce à la Finlande" [4].
La méthode repose sur l'observation directe des animaux, considérée comme la meilleure approche pour évaluer leur bien-être. Pour chaque espèce (bovins, porcs, volailles), 30 à 50 mesures ont été identifiées, correspondant à douze critères différents de bien-être [14]. Ces critères sont eux-mêmes organisés autour de quatre principes fondamentaux :
-
Bonne alimentation
-
Bon logement
-
Bonne santé
-
Respect du comportement propre à l'espèce [15]
L'outil s'appuie sur des mesures réalisées à la fois sur les animaux et sur les ressources disponibles dans leur environnement. Ces mesures sont ensuite traduites en indicateurs, puis agrégées en un score final qui reflète le niveau global de bien-être [13].
En pratique, l'utilisation de cet outil nécessite plusieurs heures d'évaluation (de 45 minutes pour une version simplifiée à 2h30 pour une évaluation complète) [16]. Les résultats obtenus permettent d'identifier précisément les points forts et les points faibles d'un élevage, ainsi que les leviers d'action pour améliorer la situation.
Limites et subjectivité de l'évaluation
Malgré ses qualités indéniables, l'évaluation du bien-être animal présente certaines limites qu'il convient de reconnaître. Premièrement, la mise en pratique d'une évaluation objective du bien-être animal en élevage reste complexe. L'outil Welfare Quality®, par exemple, nécessite plusieurs jours pour réaliser une évaluation complète, ce qui complique son utilisation systématique [8].
Par ailleurs, même si les critères scientifiques sont indispensables, le niveau de bien-être évalué peut être contesté selon le niveau d'exigence des évaluateurs. La question fondamentale demeure : "Est-ce que l'on veut un animal qui soit vraiment en état de bien-être ou qui vive simplement dans des conditions convenables ?" [8]. Cette interrogation souligne la part de subjectivité inhérente à toute évaluation.
Un autre défi réside dans l'équilibre entre différents types d'indicateurs. Les indicateurs basés sur l'environnement (ou sur les ressources) mesurent les conditions de vie fournies à l'animal et servent à apprécier si l'environnement permet a priori le respect du bien-être. Les indicateurs basés sur les animaux, quant à eux, reposent sur l'observation directe ou indirecte et permettent de vérifier si le bien-être est effectivement satisfaisant dans les conditions fournies [2].
Le processus d'intégration représente également un défi majeur : comment passer d'un indicateur mesuré sur un animal pour un critère donné à un score global pour l'ensemble des animaux d'un troupeau ? Et comment combiner les scores obtenus pour chaque critère afin d'obtenir une note globale reflétant fidèlement la réalité du bien-être animal ? [2]
Enfin, il est crucial de s'assurer que les indicateurs utilisés sont scientifiquement validés. L'évaluation de ces mesures s'effectue selon trois critères essentiels : la validité (mesure-t-on réellement ce que l'on croit mesurer ?), la reproductibilité (deux observateurs différents mesurent-ils la même chose ?) et la faisabilité (la mesure est-elle réalisable compte tenu des contraintes pratiques ?) [14].
Face à ces défis, de nouveaux outils plus accessibles voient le jour, inspirés de la méthode Welfare Quality® mais adaptés à une utilisation plus pratique. Ces outils sont progressivement déployés chez de nombreux éleveurs afin d'identifier les bonnes pratiques, de les diffuser et d'améliorer ainsi le bien-être animal de façon continue et pragmatique.
Bien-être animal et élevage : une cohabitation possible ?
La question de la compatibilité entre bien-être animal et pratiques d'élevage suscite de nombreux débats. Alors que les connaissances scientifiques progressent et que les attentes sociétales évoluent, il devient crucial d'examiner si les systèmes d'élevage actuels peuvent réellement garantir le bien-être des animaux tout en maintenant leur viabilité économique.
Risques liés aux différents types d'élevage
Les conditions de vie dans certains systèmes d'élevage intensifs présentent des risques significatifs pour le bien-être animal. Les densités élevées constituent l'un des problèmes majeurs : 22 poulets par m², 15 canards au m² pour les volailles, tandis que pour les porcs et les bovins, on n'atteint parfois même pas 1 m² de surface au sol pour 100 kg de poids vif [17]. Ces espaces restreints limitent considérablement les mouvements naturels des animaux.
L'utilisation de cages représente également une entrave majeure au bien-être. Comme le souligne une enquête de la Commission européenne, 96% des poules pondeuses en Europe étaient encore élevées en cages en 2019 [18]. Ces conditions de confinement sont particulièrement problématiques pour les animaux ayant des besoins comportementaux spécifiques.
Par ailleurs, certaines pratiques controversées persistent dans l'élevage conventionnel. Chez les porcs, la caudectomie (coupe de la queue) est réalisée avant 7 jours de vie pour prévenir la caudophagie, comportement agressif souvent lié au stress [19]. Quant à la castration des porcelets, généralement pratiquée entre 2 et 4 jours de vie sans anesthésie, elle vise à éviter l'odeur désagréable de la viande [19].
En revanche, les études scientifiques n'ont pas trouvé de relation statistique claire entre la taille de l'élevage et le bien-être des animaux. Néanmoins, l'accès à l'extérieur, essentiel pour le bien-être, tend à diminuer lorsque la taille de l'exploitation augmente [20].
Exemples concrets : porcs, volailles, canards
Pour les porcs, la directive européenne 2008/120/CE a permis d'améliorer significativement leurs conditions d'élevage. Elle impose notamment l'élevage en groupe des truies pendant leur gestation et la mise à disposition de matériaux manipulables pour satisfaire leur besoin naturel de fouissage [19]. Depuis 2020, des règles complémentaires concernent l'abreuvement, les matériaux manipulables et la castration [21].
Concernant les volailles, la situation varie considérablement selon les modes d'élevage. Les poulets standard, qui représentent 59% de la production française, sont généralement abattus vers 35 jours et pèsent environ 1,8 kg [22]. À l'inverse, les poulets ayant accès à l'extérieur sont abattus plus tard (vers 81 jours) et proviennent de souches à croissance plus lente [22].
Quant aux canards, notamment ceux destinés à la production de foie gras, leurs conditions d'élevage ont évolué. L'arrêté du 21 avril 2015 a marqué la fin de l'utilisation des épinettes (cages individuelles) au 1er janvier 2016, imposant désormais un élevage en groupe d'au moins trois individus [23]. Toutefois, un avis scientifique récent de l'EFSA recommande d'éviter tous les systèmes appelés "cages", qu'elles soient individuelles, de couple ou collectives [24].
Équilibre entre productivité et respect animal
Concilier rentabilité économique et bien-être animal représente un défi majeur pour les éleveurs. Néanmoins, des recherches récentes montrent qu'il existe des synergies significatives entre performance économique, environnementale et bien-être des troupeaux [25].
En effet, des animaux bien traités sont généralement plus sains et plus productifs [26]. Plusieurs approches permettent d'améliorer simultanément le bien-être animal et la productivité :
-
L'aménagement d'un environnement adapté aux besoins de l'espèce
-
Une bonne prévention des maladies, limitant le recours aux antibiotiques
-
La possibilité d'exprimer des comportements naturels
-
L'établissement d'une relation positive entre l'éleveur et ses animaux
Les technologies modernes contribuent également à cet équilibre. La surveillance électronique, par exemple, permet une détection précoce des problèmes de santé tout en maintenant un haut niveau de bien-être [26]. Cependant, comme le souligne l'INRAE, il est essentiel de ne pas remplacer le contact humain, fondamental pour établir une relation positive avec les animaux [26].
Des initiatives comme la démarche PALMIG CONFIANCE pour les palmipèdes ou l'outil d'évaluation EBENE pour les canards mulards illustrent cette volonté d'allier performance économique et respect du bien-être animal [27]. Ces démarches reposent sur des critères objectifs évalués par des organismes indépendants.
En définitive, si certains systèmes d'élevage intensifs demeurent incompatibles avec un véritable bien-être animal, des évolutions significatives et des alternatives prometteuses émergent, suggérant qu'une cohabitation harmonieuse entre élevage et respect du bien-être animal est possible, à condition d'accepter certaines transformations des modèles actuels.
Informer et responsabiliser le consommateur
Les consommateurs sont devenus des acteurs clés dans l'amélioration du bien-être animal par leurs choix d'achat. Pour exercer cette influence, ils ont toutefois besoin d'informations claires et fiables sur les conditions de vie des animaux dont proviennent les produits qu'ils consomment.
Étiquetage et mentions valorisantes
Une avancée majeure dans l'information des consommateurs est l'Étiquette Bien-Être Animal, lancée en décembre 2018. Cette initiative, fruit de la collaboration entre des ONG de protection animale et le groupe Casino, propose une échelle d'évaluation allant de A (supérieur) à E (minimal) [28]. Ce système repose sur près de 230 critères couvrant toute la vie de l'animal, du couvoir à l'abattage [28].
En 2024, huit enseignes majeures (Auchan, Carrefour, Casino, Coopérative U, Franprix, Lidl, Monoprix et Mousquetaires) se sont unies pour promouvoir cette démarche, répondant ainsi à une demande sociétale forte, puisque 82% des Français souhaitent que la France soutienne l'étiquetage obligatoire du mode d'élevage [5]. Aujourd'hui, cette étiquette couvre environ 15% de la production française de poulet de chair [5].
Reconnaître les signes de qualité
En l'absence d'étiquetage spécifique au bien-être animal sur tous les produits, certains signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) peuvent orienter les consommateurs. Le label Agriculture Biologique impose une "souffrance réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l'animal, y compris lors de l'abattage" [7]. Contrairement aux idées reçues, son cahier des charges est plus robuste en matière de bien-être animal que celui du Label Rouge, initialement focalisé sur la qualité gustative [7].
Pour les œufs, le code inscrit sur la coquille reste l'indicateur le plus fiable : 0 pour bio, 1 pour plein air, 2 pour au sol et 3 pour cage [7]. Cette transparence a d'ailleurs conduit à une baisse significative de l'utilisation des cages, passant de 80% à 56% entre 2003 et 2015 dans l'Union européenne [29].
Rôle des politiques publiques
Le ministère de l'Agriculture a engagé en 2018 un plan d'action prioritaire pour le bien-être animal, incluant l'information objective des consommateurs [30]. Actuellement, la France privilégie une approche volontaire pour l'étiquetage du bien-être animal [31].
Néanmoins, dans la feuille de route issue des États généraux de l'alimentation, le Conseil national de l'alimentation a été chargé de mener une réflexion sur l'expérimentation d'un étiquetage obligatoire des modes d'élevage, similaire à celui des œufs [8]. Parallèlement, l'ANSES a développé des lignes directrices visant à harmoniser les différents référentiels d'étiquetage [31].
Cette évolution vers plus de transparence transforme progressivement le consommateur en "consomm-acteur" [1], capable d'influencer par ses choix les pratiques d'élevage et le bien-être des animaux.
Conclusion
Le bien-être animal représente désormais une préoccupation majeure dans notre société. Cette notion, autrefois marginale, s'est progressivement imposée comme un élément fondamental guidant notre relation avec les animaux. Les cinq libertés fondamentales constituent sans doute le cadre le plus efficace pour évaluer et garantir ce bien-être, allant bien au-delà de la simple bientraitance.
Notre perception des animaux a considérablement évolué au fil des dernières décennies. Reconnus comme des êtres sensibles par la loi française depuis 2015, les animaux bénéficient aujourd'hui d'une attention accrue tant sur le plan éthique que scientifique. Cette évolution se reflète également dans les attentes des consommateurs, de plus en plus soucieux des conditions d'élevage.
Chacune des cinq libertés joue un rôle essentiel dans cette approche holistique du bien-être animal. L'absence de faim et de soif garantit les besoins physiologiques fondamentaux. L'absence de peur et de détresse protège la dimension psychologique. L'absence de stress physique ou thermique assure le confort environnemental. L'absence de douleur préserve l'intégrité physique. Finalement, la liberté d'exprimer un comportement naturel distingue véritablement le bien-être de la simple bientraitance.
L'évaluation objective du bien-être animal demeure néanmoins un défi complexe. Les méthodes d'observation comportementale, l'utilisation de l'éthologie et des outils comme le Welfare Quality® permettent certes d'établir des critères mesurables, mais une part de subjectivité persiste inévitablement.
Quant à la cohabitation entre bien-être animal et pratiques d'élevage, elle semble possible à condition d'accepter certaines transformations des modèles actuels. Des études montrent d'ailleurs que des animaux bien traités sont généralement plus sains et plus productifs, créant ainsi une synergie entre performance économique et respect du bien-être.
Le consommateur, désormais mieux informé grâce aux initiatives d'étiquetage et aux mentions valorisantes, peut jouer un rôle décisif dans cette évolution. Son pouvoir d'achat devient un levier puissant pour encourager les pratiques respectueuses du bien-être animal.
Ainsi, la prise en compte du bien-être animal ne représente pas seulement un impératif éthique mais également un facteur clé pour l'avenir de l'élevage et de notre relation avec le monde animal. L'application rigoureuse des cinq libertés fondamentales et la sensibilisation continue du public constituent donc les piliers essentiels d'une approche véritablement respectueuse des animaux qui partagent notre quotidien.

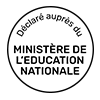
 Cours Animalia est membre de la
Cours Animalia est membre de la 


